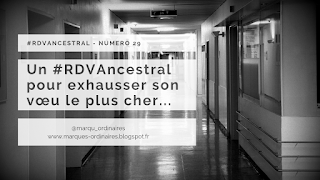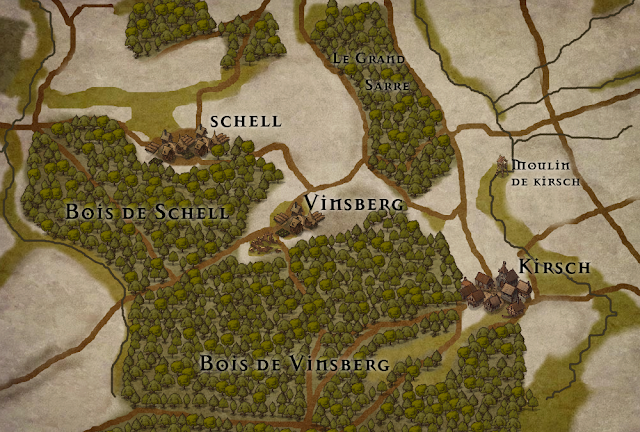***
Vendredi 18 janvier 2019. Fatigué de ma longue journée de travail, je suis confortablement assis dans mon fauteuil placé à côté de la cheminée ; vous savez, ces grandes cheminées en pierre, surmontées d'un linteau en granite et qui font le charme des maisons bretonnes. Bien installé, je me laisse à rêver... Cette douce chaleur du foyer et le crépitement des flammes me rappellent cette si belle soirée que j'avais passée auprès de la famille de Charles DANY dans l'un de mes tous premiers rendez-vous ancestraux. Peu à peu je m'assoupis...
Les yeux clos, j'entends soudain une voix qui m'interpelle. Je sursaute.
"- Eh ! Vous ! Que faites-vous ! Vous êtes en train de vous reposer ! Vous n'avez pas autre chose à faire!"
Je me relève du fauteuil dans lequel j'étais assis. Pourtant, plus de flammes, plus de cheminée bretonne. Me voilà transporté dans un autre lieu, et sans doute un autre temps, prêt pour un nouveau #RDVAncestral.
Observant rapidement la pièce où je me trouve, je n'ai aucune difficulté à reconnaître une chambre d'hôpital. Chose étonnante, je suis vêtu d'une blouse. Visiblement agacé par mon manque d'initiative, l'homme qui m'avait interpellé vient vers moi:
"- Vous êtes nouveau ici ? Sachez qu'il n'y a pas de place ici pour les paresseux ! Retournez à votre poste et que je ne vous reprenne plus !"
Cet homme doit être médecin et il doit me prendre pour un infirmier ou un aide-soignant. Peu habitué à être rabroué de la sorte, je reste sans voix pendant quelques instants. Me scrutant une dernière fois, il quitte enfin la pièce me laissant reprendre mes esprits. Comme à l'accoutumé, je ne sais qui je dois rencontrer. Le #RDVAncestral a pour principe de laisser son principal protagoniste dans le flou le plus complet. A lui de comprendre la situation et de se laisser porter au gré des événements et des rencontres...
Suivant donc mon instinct, je sors de la chambre et me dirige vers le couloir. Juste à ce moment-là, une infirmière passe et me demande d'aller dans la chambre n°230 pour vérifier si le patient n'a besoin de rien. Ne voulant pas revivre la situation de mon arrivée, je m'exécute aussitôt.
Chambre 230, nous y sommes. Je frappe à la porte et rentre dans la pièce. Une dame est assise à côté du lit, au chevet d'un homme d'une soixantaine d'année, visiblement très affaibli. Elle se retourne et me demande alors si elle doit quitter la chambre. C'est à ce moment que ce #RDVAncestral bascule.
Me voilà devant à une situation inédite et totalement déroutante. Je sens rapidement les larmes me monter aux yeux. Je me rapproche alors du patient. Je le reconnais. C'est lui. Cet homme qui est alité est mon Papi et la dame assise à ses côtés est sa sœur, ma grande-tante, toujours en vie aujourd'hui.
Je ne dois pas montrer mes émotions. Je dois me ressaisir.
Ma grande-tante rassemble alors ses affaires en disant qu'elle devait de toute manière partir car son mari l'attendait en bas depuis quelques temps. Elle embrasse son frère en lui disant ces mots :
"- Prends soin de toi, je reviendrai te voir.
- Tu crois que je le verrai mon petit-fils ?
- Mais oui que tu le verras !"
Ces mots me bouleversent. Ce petit-fils qu'il veut tant voir, n'est autre que moi...
Pendant qu'elle l'embrasse à nouveau, je remarque la date du jour inscrite sur la feuille de suivi accrochée à l'avant du lit : 20 juin 1981. Il n'y a aucun doute, je suis à quelques jours de ma propre naissance et de la disparition de mon Papi.
Après le départ de ma grande-tante, je m'approche alors de mon Papi qui, malgré la douleur et son état de fatigue, se tourne vers moi et me dit :
"- Vous savez, je voudrais tant voir mon petit-fils avant de mourir. Il doit naître bientôt. J'aimerais tant avoir la force de pouvoir vivre encore un peu."
Comment le lui-dire ? Dois-je lui avouer que je suis ce petit-fils qu'il désire tant voir de ses propres yeux ? Je doute qu'il va me croire. Et puis, qu'ai-je à perdre ? Je m'en voudrai sans doute toute ma vie de ne pas lui avoir dit. C'est la seule occasion que nous avons de nous rencontrer. Je ne dois pas manquer ce moment !
"- Pierre, j'ai un aveu à vous faire. Je suis votre petit-fils, Sébastien. C'est peut-être difficile à croire, mais je viens dans ce que nous appelons le #RDVAncestral. Je suis sans doute venu ici aujourd'hui pour corriger votre vœu le plus cher et qui n'a pas pu être exhaussé. "
Son regard s'attendrit et je vois une larme couler sur sa joue. Il me croit ! Les liens du cœurs sont plus fort que la raison. La gorge nouée, je me mets à pleurer et entre deux sanglots je m'approche de lui et le prend dans mes bras: "Oh papi ! Je suis si heureux !". Nous restons un long moment l'un contre l'autre. Je suis bien. Nous sommes biens.
Sentant que mon #RDVAncestral s'achève ici, je me relève, j'embrasse Papi une dernière fois et lui dit adieu. Visiblement soulagé, il pose sa tête sur l'oreiller et ferme les paupières...
***
Les bruits de l'hôpital laissent peu à peu la place aux crépitements des flammes. J'ouvre les yeux. Je suis à nouveau assis dans mon fauteuil, heureux d'avoir pu exhausser le vœu de mon grand-père, et en espérant au plus profond de mon cœur, que cette rencontre s'est réellement déroulée...