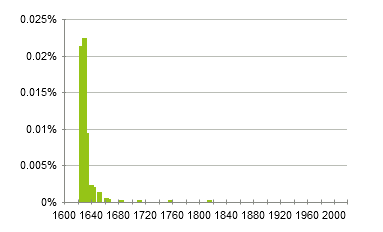Ce texte est une version corrigée et augmentée d’un texte que j’avais écrit en 2013.
Papi,
Tu vois le jour le 23 octobre 1923 dans le village de Vinsberg. Cela fait maintenant quelques petites années que la Moselle a réintégré la France, non sans difficultés. Tes parents, Pierre et Céline découvrent la vie française. Nés allemands en 1897, ils ont cependant reçus une éducation « à la française ».
Pierre HOURTE, en malgré-nous
A l’âge de 3 ans, ta chère maman trouve le repos éternel, partie trop tôt, à l’âge de 29 ans… Ton père en est très attristé, mais quelques mois plus tard, il rencontre Clémence, qui s’occupera de toi comme de son propre fils. Au moins, tu n’auras pas manqué d’amour, avec ta sœur et ton frère qui naîtront de ce mariage.
Au début des années 1930, toute la famille quitte Vinsberg pour s’installer à Marange-Silvange. La vie de la ferme devenait difficile et l’appel des usines qui cherchaient de la main d’œuvre avait décidé ton père à entrer comme ouvrier dans l’usine d’Hagondange.
1939, la guerre éclate. Tu as presque 16 ans. C’est d'abord la drôle de guerre, rien ne se passe vraiment ; et puis, en mai 1940, les soldats allemands envahissent la France. La Moselle et l'Alsace revivent les moments terribles de 1871 et sont intégrées au Reich... Malgré-toi, tu deviens allemand.
En 1942, tu as 19 ans. La guerre perdure. La police allemande t'as arrêté sans ménage car elle te soupçonne de sabotage à l'usine où tu travailles. Tu pars dans un camp de prisonniers.
Quelques mois plus tard, comme tous les jeunes de ton âge, tu es contraint de prendre l'uniforme allemand, le Feldgrau. Tu entres dans la Wehrmacht. Après trois mois de formation, tu pars ensuite à Allenstein (dans l’actuelle Pologne) au sein du 11ème Bataillon de Réserve d’Artillerie.
En mai 1943, tu es en permission à Marange, chez tes parents. Au moment de partir, tu as une petite altercation avec une jeune fille de la commune qui fait partie de la Bund Deutscher Mädel (Version féminine de la Jeunesse Hitlérienne). Celle-ci t’as sans doute dénoncé car ta famille n’auras plus de nouvelles de ta part pendant plus d’un an.
Après ton retour à Allenstein, tu es hospitalisé, ce qui retardera ton arrivée sur le front.
En octobre 1943, tu entres dans la 5ème Batterie du 11ème Régiment d’Artillerie qui combat sur le front de l’Est. C’est la destination la plus commune pour les Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés de force dans la Wehrmacht, ceci pour éviter toute tentation de fuite.
23 octobre 1943... Voilà un bien triste anniversaire. Le jour de tes 20 ans, tu arrives sur le front, non loin de Leningrad. Devant toi, il n'y a plus aucun arbre, seulement la désolation, la boue, des cratères et des cadavres. Sur un tronc, tu aperçois une main arrachée par un obus… A 20 ans, on ne mérite pas de voir ces choses-là… Les seuls mots qui te viennent sont "Oh maman...".
Tu vis ensuite l'horreur de la guerre et tu n'as jamais vraiment voulu en parler. Tu participes ensuite à différents combats : Narwa, Pernau, Riga... Toutes ces informations, je les tiens des archives de Berlin.
En février 45, après une longue retraite vers l’actuelle Lettonie, tu es blessé pendant la bataille de Kurland. C’est un soldat allemand qui te sauvera, toi, Alsacien-Mosellan. Tu lui en seras reconnaissant toute ta vie.
La Bataille de Narwa (Wikipedia)
Pendant un moment, tu es resté paralysé. Tu es ensuite envoyé à l'hôpital à Regensburg (Ratisbonne). La blessure étant sévère, tu y restes pendant le restant de la guerre. Lorsque l'on connait le sort des soldats allemands qui ont combattu à Kurland, je crois que cette blessure, aussi douloureuse soit-elle, t'a sauvé la vie...
Mai 1945, tu es libéré de l'hôpital. Après avoir récupéré quelques habits civils, tu prends la route pour rejoindre la Moselle. Le 24 mai 1945, une hirondelle entre dans la chambre de ta sœur. Elle est annonciatrice d’une bonne nouvelle : ton retour.
Certes, tu reviens blessé, amaigri, mais tu es redevenu français, et surtout libre.
Je n'ai malheureusement pas connu mon papi, car il nous a quitté quelques jours après ma naissance. Les blessures de la guerre et les traitements contre ses maux l'ont rendu malade. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui, il repose en paix, loin des tourments de cette triste période.